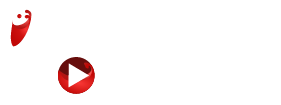Des cépages alsaciens sous pression
Le 21 mars dernier, la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden a accueilli une conférence captivante sur la viticulture et le changement climatique, animée par Frédéric Schwaerzler, de la Chambre d’Agriculture d’Alsace, et Mathieu Boesch, viticulteur. Cet échange a permis de mettre en lumière l’impact du réchauffement climatique sur les vignobles alsaciens et les défis qui en découlent.
Les cépages emblématiques de la région ne sont pas épargnés : le Riesling, reconnu pour sa finesse et son équilibre, souffre des fortes chaleurs qui accélèrent sa maturation et déséquilibrent son profil aromatique. Comparé à un sprinter, il s’épuise rapidement sous un soleil intense, contrairement au Pinot Noir, plus apte à gérer ces variations grâce à sa capacité à fermer ses stomates. Le Pinot Gris, quant à lui, est confronté à une maturation toujours plus précoce, compliquant la gestion de la récolte et du style des vins produits. Traditionnellement utilisé pour des vins moelleux, il pourrait évoluer vers d’autres expressions en raison du changement climatique. De son côté, le Pinot Noir gagne en importance, notamment dans la production de crémants, mais son adaptation dépend du choix judicieux des clones et des porte-greffes.
Innovation et expérimentation pour s’adapter
Pour répondre à ces bouleversements, l’expérimentation de nouveaux cépages constitue une piste prometteuse. Frédéric Schwaerzler a présenté plusieurs variétés résistantes, notamment le Voltis et le Johanniter, qui offrent une meilleure tolérance aux maladies comme le mildiou et l’oïdium, tout en s’adaptant aux conditions climatiques extrêmes. Ces cépages, bien que récents, suscitent un intérêt croissant et font l’objet de nombreux essais sur le terroir alsacien afin d’évaluer leur potentiel. L’enjeu n’est pas seulement agronomique, il faut aussi préserver l’identité gustative des vins d’Alsace.
En parallèle, les viticulteurs explorent d’autres solutions pour protéger leurs vignes des excès climatiques. L’installation de filets d’ombrage au-dessus des parcelles est une des stratégies testées pour limiter les brûlures des grappes et réduire la température au sein du vignoble. La gestion de l’eau devient également une préoccupation majeure, avec un recours accru à des porte-greffes plus résistants à la sécheresse. Toutefois, la diversité reste essentielle : certains porte-greffes tolèrent mal le gel hivernal, ce qui oblige à une réflexion approfondie sur les combinaisons à privilégier. Enfin, la gestion de la vigueur et de la charge des vignes est un levier crucial pour maintenir la qualité des raisins : dans les sols les plus légers et sensibles au stress hydrique, il devient impératif d’adapter la taille et de limiter la quantité de grappes par pied pour éviter une dilution des arômes.
Biodiversité et résilience, une nouvelle approche du vignoble
Outre ces innovations techniques, la biodiversité est désormais perçue comme un atout majeur pour renforcer la résilience du vignoble. Sylvain Boesch, chargé de mission à la Maison de la Nature, a insisté sur la nécessité de préserver un écosystème riche au sein des parcelles viticoles. Des initiatives locales, comme la plantation de haies et la création de corridors écologiques, sont mises en place pour favoriser la présence d’insectes pollinisateurs et de prédateurs naturels des ravageurs. Ces pratiques, inspirées de l’agroécologie, permettent non seulement de réduire l’usage des intrants chimiques, mais aussi de créer un environnement plus stable et résilient face aux aléas climatiques.
Restaurer la biodiversité, c’est aussi renforcer la capacité du sol à retenir l’eau et limiter l’érosion, deux enjeux cruciaux dans un contexte de dérèglement climatique.
Un avenir à construire ensemble
Cette conférence a mis en évidence l’ampleur des défis qui attendent les viticulteurs alsaciens, mais elle a aussi souligné les nombreuses pistes d’adaptation qui émergent. Entre innovations techniques, expérimentation de nouveaux cépages et engagement en faveur de la biodiversité, la viticulture alsacienne se réinvente pour faire face aux bouleversements climatiques.
Toutefois, cette transition ne pourra se faire qu’avec une coopération étroite entre les viticulteurs, les chercheurs et les institutions agricoles. Plus qu’une simple activité économique, la viticulture en Alsace est un héritage culturel et paysager qu’il est essentiel de préserver. Face à l’urgence climatique, c’est ensemble que les acteurs du secteur doivent œuvrer pour garantir l’avenir de ce patrimoine unique, en conciliant respect des traditions et innovations durables.